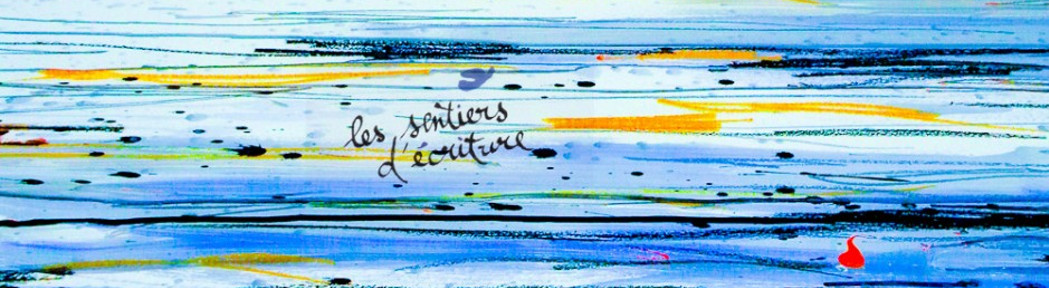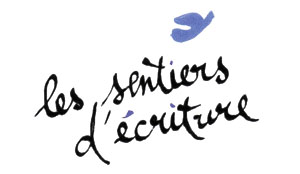 Ecrire, c’est laisser remonter du fond de soi
Ecrire, c’est laisser remonter du fond de soi
la vieille et insatiable curiosité de l’enfance,
le désir de découvrir ce qui va venir
Philippe Forest
Ecrire la vie quotidienne, le temps qui passe, ce qui fait le sel de nos vies.
Ecrire pour savoir ce que je veux dire.
Ecrire pour le plaisir ou pour transmettre.
Ecrire pour soi mais avec d’autres. Ecrire dedans, écrire dehors
Ecrire grave ou léger.
Ecrire souvent ou de temps à autre
Ecrire avec les artistes
Ecrire pour ne pas mourir
Les Sentiers d’écriture proposent des ateliers dans lesquels l’écriture est en jeu, qu’il s’agisse d’écriture autobiographique, poétique, ludique ou de lecture, de photographie, de carnets de voyage ou de bricolage autour du livre.
A travers ces aventures de langage et de création, nous voulons encourager la créativité de chacun, favoriser la réalisation de projets personnels, la transmission des textes.
Les liens de confiance et de solidarité qui se tissent entre les participants permettent chacun de s’impliquer dans son travail d’écriture. Ils contribuent à la reconnaissance des personnes dans la richesse de leur singularité.
Les Sentiers d’écriture se situent dans le mouvement d’Éducation populaire.
Aucun préalable n’est requis pour participer aux ateliers sinon le désir de partager une expérience relationnelle et culturelle, en acceptant les règles et le mode de fonctionnement de l’association.
Le siège de l’association est actuellement situé à Montpellier.